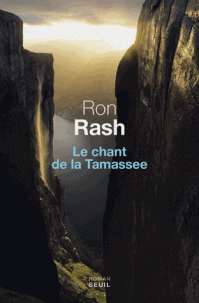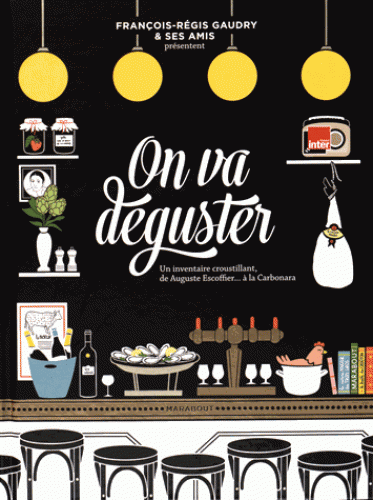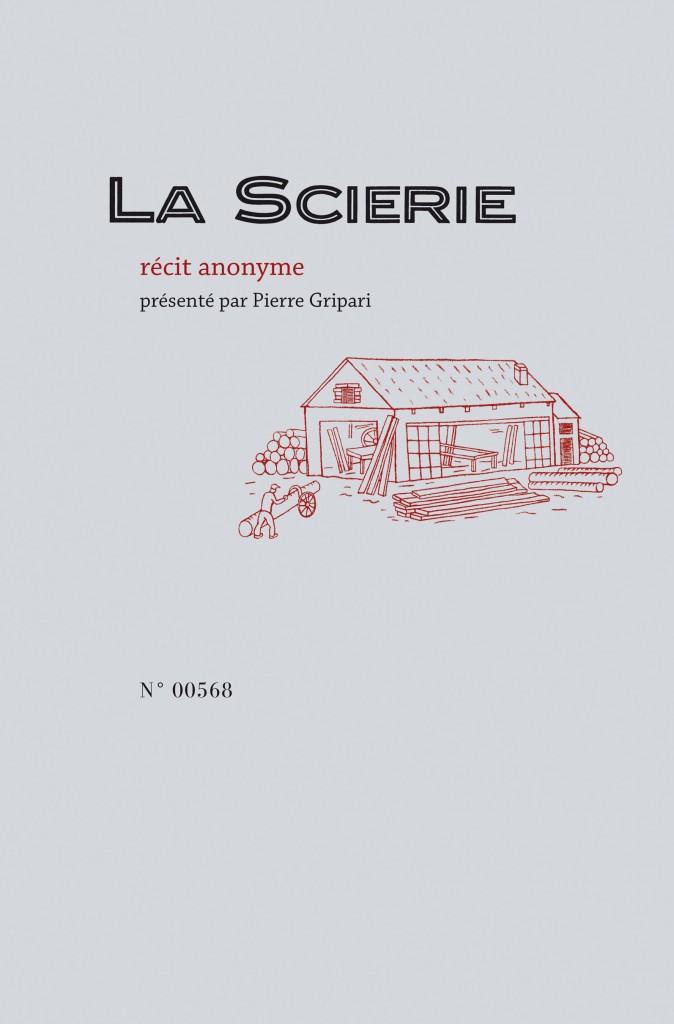![]()
Un roman de la maturité dans lequel Yvette Z’Graggen dresse le portrait d’une femme comme une autre.Ou pas? Héroïne qui s’ignore, femme invisible sublimée par un amour inattendu, Cornelia s’éveille. Pour le plus grand plaisir des yeux.
Passer à travers les journées sans trop y réfléchir, accepter de se « faire quitter » par un mari qu’on a subi plutôt qu’aimé, se contenter de la compagnie de deux oiseaux en cage et d’un travail de secrétaire, Cornelia vit sans désir.
Puis resurgit cette amie, la seule, Francesca, à l’avoir prévenue, jadis, qu’il n’était pas encore venu, à vingt ans, le temps du mariage et qu’elle ferait mieux d’attendre avant de se jeter dans les bras de ce Guillaume et de se laisser glisser la bague au doigt. Mais Cornelia s’était entêtée et la voilà, des années plus tard, divorcée, les enfants partis, bien obligée de reconnaître que c’était Francesca qui avait raison. Alors il faut aller à Rome, puisqu’elle l’appelle à son chevet moribond, revoir l’amie clairvoyante, renouer avec cette époque de sa vie où elles vibraient ensemble, avant que la mort ne les fauche.
Dans l’avion qui les mène à Rome, elle rencontre Peter. Ou plutôt, c’est Peter qui la rencontre, car Cornelia ne sait que se laisser guider, elle qui n’a jamais songé à entreprendre. Il la voiture jusqu’à son hôtel, l’invite à diner, l’embrasse dans une ruelle. Ils se reverront à Genève, lorsqu’il en décidera ainsi.
À armes inégales
Car cette liaison qui démarre comme un feu de grange a tout du déséquilibre : il est marié, elle se prétend veuve, il a deux filles, elle a effacé ses enfants de sa mémoire, il impose le rythme de leurs rencontres, elle attend. Petit à petit, Cornelia se métamorphose, se met à nu, ose. Au travail, ses collègues s’interrogent : « Qu’a-t-elle donc, notre Cornette ? ».
Bien qu’inexpérimentée, Cornelia pressent qu’elle joue à un jeu qu’elle ne peut que perdre. Il faut simplement que cela dure le plus longtemps possible, cette incomparable ivresse. Il ne faut pas s’aimer trop, lui assène Peter qui, lui aussi, sent combien l’amour nous arrache aux réalités quotidiennes et nous oblige, tôt ou tard, à trancher.
Tout en nuances
Yvette Z’Graggen, haute voix de la littérature romande, invente pour le coup un narrateur observateur qui s’efforce de démêler les émotions des uns et des autres, d’en saisir les nuances. Comme souvent chez cette auteure, c’est sur la femme qu’elle s’arrête, n’hésitant pas à montrer sa complicité et sa tendresse pour ce personnage écorché et à l’accompagner dans sa chute.
Combien il y a-t-il de Z’Graggen dans Cornelia ? Peu importe, finalement. Le cœur de l’homme demeure un mystère pour la femme, Peter pour Cornelia, et l’écriture seule permet de lever un coin du voile sur une histoire d’amour pas si banale. (sbr)