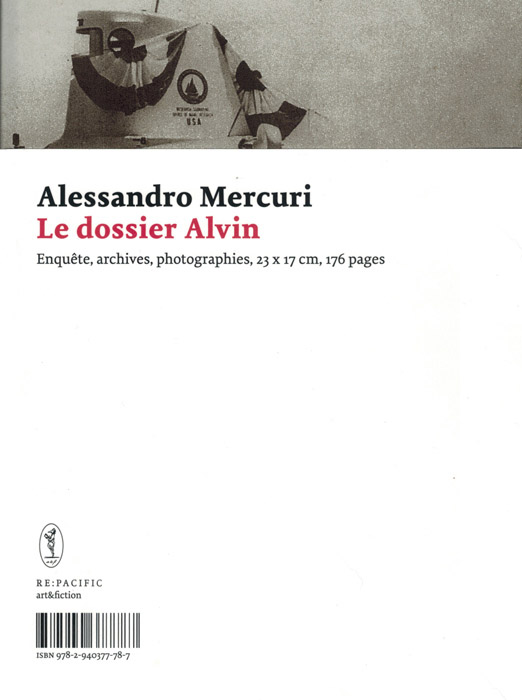![]()
Prendre la route avec le Genevois Joseph Incardona, c’est prendre le risque de se prendre un bus en pleine gueule. Un polar noir, sans lait, mais avec du stupre.
Gd Prix de Littérature policière 2015.
Il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas prendre la route. Ainsi de Joseph Incardona. Pas que l’écrivain soit spécialement mauvais conducteur, ça on n’en sait rien, mais parce qu’une fois embarqué dans son roman, il ne nous laisse pas une seule fois descendre de voiture. Embedded, comme on dit. Vitres et portières verrouillées, à pas vous laisser souffler une seconde.
Imaginez un circuit fermé. Celui du réseau autoroutier français, ses péages, ses aires, ses espaces de détente, ses urinoirs posés au milieu de nulle part et ses quelques neuf milliers de kilomètres arachnéens. Un espace confiné, anxiogène, où la seule envie du chauffeur PL / commercial / vacancier, après y avoir pénétré, est d’en ressortir le plus vite possible. Tel un aliment aussitôt évacué après avoir été ingurgité et avoir parcouru les quelques 9 kilomètres d’intestin grêle.
Un monde en pointillés
Avec Derrière les panneaux, il y a des hommes, Incardona s’arrête plus longtemps que de raison. D’abord pour y poser un fait divers glauque – la disparition de gamines d’une dizaine d’années, petites affiches, dispositif Alerte-Enlèvement et sentiment d’horreur générale en un 15 août caniculaire et forcément paroxystique, ensuite pour s’intéresser à la drôle de frange de personnages qui s’y croisent, frôlent, côtoient sans jamais vraiment se regarder. Pascal, le cuistot muet et multiple employé du mois ; Gérard, le patron bedonnant et libidineux ; Pierre, le père foudroyé, plus mort que vivant ; Julie Martinez et Thierry Gaspard, la flicaille de service qui en pince réciproquement ; Jacques, le collectionneur d’objets égarés / abandonnés / volatilisés ; Lola, Bernard et les autres… Incardona brasse une foule de portraits aux profils sociétaux plus vrais que nature. Adepte d’un sex’n roll plutôt cash, il compense par une litanie de données qui poussent l’introdescription jusqu’à sa parfaite mise en lumière, et des considérations qui sont de constantes remises en question d’une existence en ordre de marche forcée. C’est un polar où la course-poursuite est avant tout psychologique, du Fast & Furious avec marche –arrière, pas de côté et coups de boule, mais toujours sous le haut-patronage d’une langue qui colle au genre. Ecrivant par petites phrases, trois mots par ci, un aphorisme par là, Incardona ne donne que l’essentiel. Il nous laisse nous intéresser à chacun de ses personnages, la trame finalement n’étant là que pour servir de bande déroulante où le happy end est couru d’avance, mais laisse longtemps en bouche un arrière-goût un rien désenchanté. « Life is a killer » disait le poète américain John Giorno. Il n’est pas un des personnages de Joe Incardona qui viendrait le contredire. (mp)
Derrière les panneaux, il y a des hommes, Joseph Incardona, éd. Finitude, 278 p. (www.finitude.fr & www.josephincardona.com)