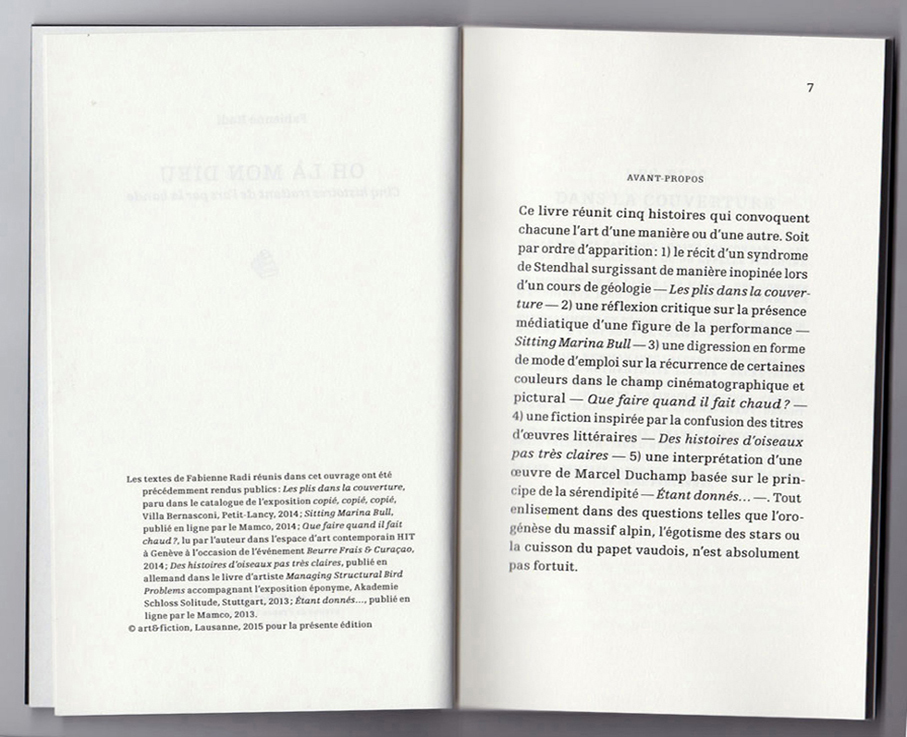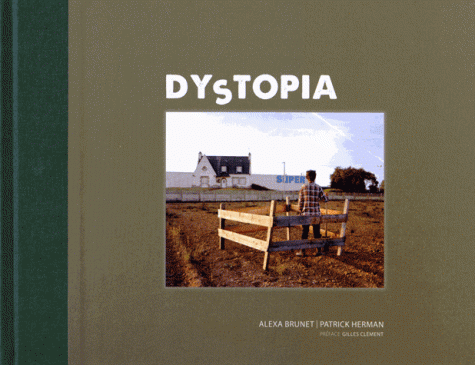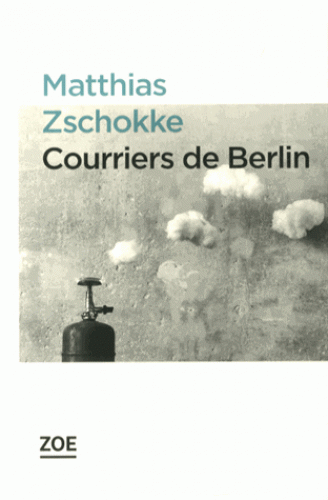![]()
Obéir, ou pas. Quand la guerre civile hante la Finlande, surgissent les fantômes. Au royaume scandinave, Leena Lander is coming.
Souvent reléguée aux confins du Nord, la guerre civile qui opposa les citoyens « rouges » aux « blancs » durant l’année 1918 reste un événement plutôt méconnu chez nous. Sans entrer dans les détails historiques finalement assez aisés à saisir, Leena Lander s’attache davantage à mettre en scène trois personnages, trois egos torturés par des fautes à expier.
Déplacée dans une clinique d’aliénés transformée en tribunal militaire, Miina, jeune femme accusée de désertion, se retrouve face au juge Hallenberg, écrivain juriste recyclé pour les besoins de la cause. Le soldat qui l’a amenée ici, un jäger (chasseur de la Garde Blanche) vient de passer huit jours sur une île, seul avec elle. Intrigué par leur histoire, Hallenberg s’évertue à leur faire cracher le morceau, persuadé qu’ils ont connu lors de leur naufrage des intimités interdites entre ennemis. D’un simple interrogatoire pro forma, découvrir leur vérité deviendra une obsession.
S’enfermant instinctivement dans un mutisme manipulateur, Miina s’affame, Miina vent ses charmes, Miina affabule à tout va pour sauver sa peau. Harjula, le jäger, hanté par ses propres infamies, ne sait sur quel pied danser. Quant au juge, c’est dans le vin rouge qu’il puise la force de signer les condamnations à mort, en attendant les confessions de cette femme troublante. Trois loups d’une même meute en chasse de la proie qui fera de lui un chef.
Un roman à la fois envoûtant et intimiste, qui, à l’instar de ses héros, jongle entre les formes. Par bonheur, la tension est maintenue jusqu’au bout, nous rappelant que dans la littérature comme dans la vie, nul n’est réellement maître de son destin. (sbr)
Obéir, Leena Lander, Ed. Actes Sud, 360 p. (www.actes-sud.fr)